Le Système canadien d’aides à la navigation 2023
Table des matières
- Avant-propos
- Introduction
- Le Système canadien d’aides à la navigation
- Dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation
- Aides à la navigation de la Garde côtière canadienne
- Aides à la navigation d’autres gouvernements
- Aides privées à la navigation
- Caractéristiques des feux à éclats canadiens
- Aides flottantes à la navigation (bouées)
- Bouées latérales
- Bouées de bifurcation
- Bouées cardinales
- Bouées de danger isolé
- Bouées spéciales
- Identification de jour
- Couleur de la bouée
- Forme de la bouée
- Voyants
- Identification de nuit
- Caractéristiques des feux à éclats des bouées
- Couleurs des feux des bouées
- Matériau rétroréfléchissant
- Autres caractéristiques
- Aides fixes à la navigation
- Marques de jour et balises de jour
- Aides sonores
- Feux à secteurs
- Aides électroniques à la navigation
- Système mondial de navigation par satellite (GNSS)
- Description du système
- Norme de rendement
- Système de renforcement du GNSS
- Norme de rendement du WAAS
- Publications connexes
- Guide de sécurité nautique
- Bouées privées – Guide du propriétaire
- Aides radio à la navigation maritime
- Livre des feux, des bouées et des signaux de brume
- Avertissements de navigation
- Site Web des Avis aux navigateurs
- Édition annuelle des Avis aux navigateurs
- Tables des marées et des courants du Canada
- Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne
- Système de balisage maritime IALA / AISM
Avant-propos
La Garde côtière canadienne est ravie de présenter l’édition de 2023 de la publication intitulée Le Système canadien d’aides à la navigation. Cette édition remplace l’édition de 2011 à titre de nouvelle norme pour les aides à la navigation au Canada.
Comme vous le remarquerez, plusieurs améliorations ont été apportées à la présente édition. Ces modifications sont notamment :
- La suppression de toutes les références au DGPS, en raison de la fin du réseau canadien de radiodiffusion du DGPS depuis le 15 décembre 2022, référence au NOTMAR 1206/22.
- Le remplacement dans la version anglaise seulement, du terme « aural aid » par « audible aid », soit « aide sonore » pour s’harmoniser avec la terminologie de l’AISM. Ceci n’affecte pas la terminologie en français.
- La mise à jour de la définition de l’interprétation de la direction vers l’amont.
- Un nouveau guide de référence rapide, de style affiche, imprimable en 2 versions différentes:
- sur 3 feuilles de 8,5x11 pouces;
- sur 3 feuilles de 11x14 pouces (taille de police plus grande).
- La révision de la section Dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation pour refléter les lois et règlements actuels relatifs aux aides à la navigation.
- Le changement de l’appellation de la Loi sur la protection de la navigation (LPN), renommée Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC).
- Le changement de l’appellation du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques, 1995, maintenant consolidé dans le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- Le changement de l’appellation des Avis à la navigation (AVNAV), désormais appelés Avertissements de navigation (AVNAV).
- Par souci de sécurité et de concordance entre les versions anglaise et française, la définition de la bouée de plongée a été corrigée et reflète maintenant le texte original.
- L’ajout de nombreux liens.
- L’ajout de références à l’AIS AtoN.
- L’ajout de références visuelles (dessins).
Introduction
Généralités
Définition
Les aides à la navigation sont des systèmes ou des dispositifs extérieurs aux navires, installés pour aider les navigateurs à déterminer leur position et leur cap, pour avertir de la présence de dangers ou d’obstacles ou pour indiquer le meilleur trajet ou le trajet privilégié.
Public visé et utilisations
Cette publication de référence sur les aides à la navigation est destinée à un large public évoluant dans un environnement maritime. Elle fournit des directives :
- aux navigateurs du Canada et du monde entier qui utilisent ou prévoient d’utiliser les aides à la navigation canadiennes pour naviguer en toute sécurité dans les eaux canadiennes;
- sur l’interprétation, les objectifs et les caractéristiques des aides à la navigation;
- pour consulter rapidement les publications et législations relatives aux aides à la navigation.
Le format carte peut être imprimé et utilisé comme guide de référence rapide (horizontal) (PDF, 1,95 Mo, disponible en format PDF seulement) et contient des informations condensées. De plus, la vidéo peut être utilisée comme complément sonore et visuel.
Responsabilité
La Garde côtière canadienne est mandatée, mais elle n’est pas tenue, de fournir les aides à la navigation en eaux canadiennes à l’exception des voies navigables telles que la voie maritime Trent-Severn et le canal Rideau, qui sont desservies par Parcs Canada. La Garde côtière canadienne s’engage à fournir, comme elle le juge pratique et nécessaire, les aides à la navigation justifiées par les politiques, les procédures et les directives existantes.
Autres publications
Afin de faciliter une compréhension et une interprétation adéquates de leurs fonctions, il faut utiliser les aides à la navigation de concert avec le Système canadien d’aides à la navigation et d’autres publications maritimes, notamment les cartes marines, le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume, les Aides radio à la navigation maritime, les Avertissements à la navigation (AVNAV), les Avis aux navigateurs (NOTMAR), les Instructions nautiques du Canada, et la publication Bouées privées – guide du propriétaire (PDF, 987 Ko, disponible en format PDF seulement).
Le Système canadien d’aides à la navigation
Le Système canadien d’aides à la navigation est constitué d’un ensemble d’aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation.
Aides visuelles
Les aides visuelles sont des aides à la navigation de courte portée, comprenant les bouées, les balises de jour, les marques de jour et les feux. Au Canada, un système combiné d’aides visuelles latérales et cardinales est utilisé. La connaissance des caractéristiques de chacun de ces types fondamentaux d’aides sont un préalable à l’utilisation sécuritaire du système.
Aides latérales
Le système latéral de balisage utilisé en eaux canadiennes est celui de la région B de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM) (en anglais seulement) (se reporter à la section du système de balisage maritime de l’AISM du présent manuel). Les aides latérales peuvent être des bouées ou des aides fixes. Ces aides balisent l’emplacement des dangers ainsi que celui du chenal le plus sécuritaire et le plus profond en indiquant de quel côté passer.
Pour bien interpréter les aides latérales, il faut connaître la direction du balisage qui correspond à celle de l’amont. En général, la direction vers l’amont est celle d’un navire venant de la mer qui fait route vers la source d’un cours d’eau ou vers un port.
Lorsqu’un navire va vers l’amont, il doit laisser sur tribord (à droite) les aides de tribord et sur bâbord (à gauche) les aides de bâbord.
Aides cardinales
Les aides cardinales peuvent être des bouées ou des aides fixes.
Les aides cardinales balisent l’emplacement des dangers ainsi que celui du chenal le plus sécuritaire ou le plus profond par rapport aux points cardinaux. On compte quatre marques cardinales, soit nord, est, sud et ouest. Ces aides sont placées de telle manière que le chenal le plus sécuritaire ou le plus profond se trouve dans le quadrant indiqué par la marque (par exemple, au nord d’une bouée cardinale nord).
Aides sonores
Les aides sonores sont des dispositifs émettant un son qui avertit le navigateur d’un danger dans des conditions de faible visibilité. Les bouées à cloche et à sifflet sont activées par le mouvement des vagues. Les signaux de brume sur la côte sont utilisés lorsque la visibilité est réduite à moins de deux milles marins. Voir la section Aides sonores du Système canadien d’aides à la navigation.
Aides électroniques
Les aides électroniques utilisées dans le système canadien comprennent les aides à la navigation du système d’identification automatique (AIS AtoN), les réflecteurs radar et les balises radar.
L'avènement de la navigation électronique et ses nombreuses possibilités font l'objet d'un suivi des incidences potentielles et d'une mise en œuvre pour répondre à l'évolution des besoins de la navigation. Les mesures prises à ce jour comprennent entre autre, l'introduction de technologies permettant de nouveaux types d'aides électroniques à la navigation.
Afin de demeurer conforme au langage utilisé par nos partenaires internationaux, ce document emploie l’acronyme anglais « AIS AtoN » (Automatic Information System Aids to Navigation), généralement accepté pour désigner le Système d’identification automatique d’aide à la navigation.
Les réflecteurs radar sont des dispositifs passifs qui sont utilisés pour améliorer l’image radar des aides à la navigation alors que les balises radar (RACON) sont des dispositifs actifs qui, en renvoyant un signal radar identifiable, permettent de reconnaitre avec précision l’emplacement qu’ils marquent.
Remarques :
- Une liste détaillée des AIS AtoN figure sur la carte interactive du Portail e-Navigation du Canada.
- Une liste détaillée de toutes les aides visuelles lumineuses et de tous les signaux de brume figure dans la publication Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.
- Une liste détaillée de tous les radiophares et de toutes les balises radar figure dans la publication Aides radio à la navigation maritime.
Navigation en hiver
L’état des glaces en hiver peut nécessiter l’enlèvement des bouées et la clôture de la saison de navigation. Le fonctionnement des aides à la navigation et des systèmes électroniques connexes sur le littoral peut également être interrompu à ces moments-là. Certains feux peuvent être remplacés par des feux d’intensité plus faible.
Lorsque les conditions imposées par les glaces sont moins rigoureuses, les bouées non lumineuses utilisées en été peuvent être laissées en place ou des bouées lumineuses peuvent être remplacées par des bouées à espar d’hiver non lumineuses. Les navigateurs qui empruntent des chenaux marqués par de telles bouées en dehors de l’ouverture officielle de la saison de navigation sont mis en garde du fait que ces aides n’occupent pas nécessairement la position prévue en raison des tempêtes et du déplacement des glaces.
L’ouverture et la fermeture de la navigation, l’enlèvement saisonnier, le remplacement ou le positionnement des bouées et la suspension temporaire d’autres aides à la navigation sont toujours annoncés. Les navigateurs sont encouragés à consulter les bulletins diffusés par les stations radio maritimes locales, les Avertissements de navigation (AVNAV) et les Avis aux navigateurs (NOTMAR) publiés pour obtenir ces renseignements.
Navigation de nuit
Les bouées et les aides fixes peuvent être renforcées par un feu et un matériau rétroréfléchissant. Ce dernier est activé par une source lumineuse, comme un projecteur, il est coloré pour indiquer le type de l’aide, et pour les bouées de courte portée, affiche les numéros d’identification, les lettres ou symboles.
Vitesse et navigation
Il ne faut pas s’attendre à ce que les systèmes d’aides à la navigation fonctionnent adéquatement en cas de vitesse excessive. La Garde côtière canadienne conseille aux navigateurs de respecter, le cas échéant, les limites de vitesse locales et de faire preuve de jugement dans les autres situations. Il incombe à tous d’éviter les collisions lorsqu’ils utilisent une voie navigable.
Les navigateurs sont instamment priés de réduire leur vitesse et de faire route prudemment par mauvais temps, lorsque la visibilité est réduite ou près de dangers physiques (notamment de nuit, dans les secteurs à risque ou très fréquentés ou lorsque de la glace s’est formée). Dans ces conditions, il faut tenir compte de la possibilité de panne du matériel, des limites des aides à la navigation et de la réduction du délai de réaction. Des difficultés qui ne font que s’aggraver à grande vitesse.
La Règle 6 du Règlement sur les abordages établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada donne des lignes directrices relatives à la vitesse sécuritaire.
Avertissements afférents à l’utilisation des aides à la navigation
- Les navigateurs sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier uniquement aux bouées lors de la navigation. Dans la mesure du possible, la navigation doit également se faire au moyen de relèvements ou de mesures d’angles utilisant des aides fixes sur la côte ou des amers indiqués sur les cartes et au moyen de sondages ou, si possible, d’appareils de radionavigation ou de navigation par satellite.
- La plupart des aides à la navigation ne sont pas en observation continue et les navigateurs doivent être conscients que des défaillances et des déplacements peuvent se produire. La Garde côtière canadienne ne garantit pas que toutes les aides à la navigation fonctionnent de la manière annoncée ou à la position annoncée en tout temps. Les navigateurs qui découvrent des aides à la navigation défectueuses, hors position, fonctionnant avec le service de secours, qui présentent des caractéristiques inadéquates, endommagées ou manquantes doivent immédiatement signaler ces problèmes au centre le plus proche des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou au bureau de la Garde côtière canadienne le plus proche.
- Les aides à la navigation sont susceptibles d'être endommagées, de tomber en panne ou de s'écarter de leur position, ce qui peut être causé par les glaces, les tempêtes, les collisions avec des navires et des pannes de courant. Les dommages causés par les glaces ou les tempêtes peuvent être très étendus et nécessiter une période considérable de réparations. Des dommages causés à une aide isolée peuvent ne pas être découverts et signalés avant longtemps. Les aides flottantes et les feux de jetée situés dans ou à proximité d’eau et qui sont exposées à des contraintes particulièrement rigoureuses lors du mouvement des glaces sont les plus exposés au risque de dommages.
- Les navigateurs sont avertis que les aides à la navigation peuvent ne pas présenter les caractéristiques annoncées. Les feux peuvent s’éteindre ou apparaître avec une intensité réduite et les signaux sonores peuvent cesser de fonctionner à cause de la glace, de collisions, de défaillances mécaniques, et dans le cas des bouées à cloche ou à sifflet, à cause des eaux calmes. La forme d’une aide à la navigation peut être modifiée par l’accumulation de glace ou en raison de dommages. Sa couleur peut aussi être altérée par les embruns verglaçants, l’accumulation d’algues marines ou de fientes d’oiseaux. Les aides de l’AIS, les transpondeurs ou les systèmes terrestres peuvent tomber en panne, et des erreurs peuvent être introduites par certains systèmes de navigation électronique.
- La position des bouées indiquée sur les cartes marines n’est qu’approximative. Un certain nombre de facteurs limitent la précision du positionnement des bouées et de leurs ancres. Par exemple, les conditions atmosphériques ambiantes, l’état de la mer, les conditions de marée et de courant, la configuration du fond marin, le fait que les bouées sont amarrées à leurs ancres par des chaînes de différentes longueurs et qu’elles peuvent dériver autour de leur position indiquée sur la carte dans les limites de leur amarrage.
- Sachant que les glaces en mouvement sont susceptibles de déplacer les bouées de leur position annoncée, les navigateurs doivent procéder avec une extrême prudence dans ces circonstances.
- Il est rappelé aux navigateurs qu'en raison des différences dans le système de référence horizontal (c'est-à-dire NAD 27, NAD 83, WGS84), le quadrillage des cartes d’une région peut varier d’une carte à l’autre. Lorsqu’on détermine la position des aides à la navigation au moyen de la méthode de la latitude et de la longitude, les résultats doivent être vérifiés par rapport aux autres informations disponibles.
- Dans certains cas où il est nécessaire de mouiller une bouée à proximité d’un danger à la navigation (par ex. un haut-fond, un récif ou une bordure de récif), le symbole de la bouée sur la carte peut être légèrement déplacé dans la direction des eaux sûres afin de ne pas obstruer ou cacher l’indication du danger représenté. De tels déplacements seront signalés sur la carte par une flèche.
- Les navigateurs doivent éviter de naviguer trop près d’une bouée pour ne pas risquer de la frapper ou de heurter son système d’ancrage ou l’obstacle sous-marin qu’elle indique.
- Bon nombre de feux automatiques sont dotés d’interrupteurs à cellule photoélectrique. Ces feux, tant sur les côtes que sur la plupart des bouées, peuvent être éteints entre le lever et le coucher du soleil. Il ne faut donc pas présumer que les feux ne fonctionnent pas normalement quand ils ne sont pas visibles de jour.
- Les conditions atmosphériques peuvent avoir des effets considérables sur la transmission de la lumière et la visibilité des feux. Par exemple :
- La distance du feu ne peut pas être évaluée avec exactitude uniquement d’après son éclat apparent.
- La nuit, il est difficile de distinguer si un feu isolé est blanc, jaune ou bleu, sauf à distance rapprochée.
- Dans certaines conditions atmosphériques, les feux blancs et jaunes peuvent présenter une teinte rougeâtre.
- Les caractéristiques visibles d’un feu alternatif présentant des phases d’intensité lumineuse différentes peuvent varier selon la distance du fait que certaines phases peuvent ne pas être visibles.
- Lorsqu’ils sont observés à des distances similaires, les feux à faible intensité sont plus facilement obscurcis lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises que les feux plus puissants. Les feux colorés peuvent sembler avoir une intensité inférieure à celle des feux blancs et sont plus difficiles à repérer dans des conditions défavorables.
- De la glace, du givre, de l’humidité ou de la saleté peuvent se former sur la lanterne des feux par temps froid ou au fil du temps, ce qui peut notamment réduire leur visibilité et pourrait donner l’impression que les feux colorés sont blancs.
- Un feu produisant un éclat très court peut ne pas être visible à une aussi grande distance qu’un feu produisant un éclat plus long.
- Le navigateur doit éviter de se fier uniquement à la couleur lorsqu’il se sert d’un feu à secteurs, mais il doit également contrôler sa ligne de position en relevant le feu. De chaque côté de la ligne de démarcation entre le blanc et le rouge, et aussi entre le blanc et le vert, se trouve un petit arc de couleur indéfinissable.
- Lorsque l’arc de visibilité d’un feu est coupé, par example par une pente de terrain, le relèvement auquel il disparaît ou apparaît variera avec la distance de l’observateur et la hauteur des yeux.
- L’observation d’un feu peut être affectée de manière négative dans différentes situations, comme un arrière-plan fortement éclairé ou encore un arrière-plan coloré ou changeant.
- Aides sonores à la navigation. Compte tenu de la distance variable à laquelle un signal de brume peut être entendu en mer et du fait qu’il y a souvent de la brume près d’une station dotée d’un avertisseur de brume sans pour autant qu’elle soit visible de la station, les navigateurs doivent noter que :
- lorsqu’ils approchent de la côte dans la brume, ils ne doivent pas se fier uniquement aux signaux de brume, mais doivent toujours prendre des sondages qui, dans presque tous les cas, donnent un avertissement suffisant du danger.
- ils ne doivent pas estimer la distance qui les sépare d’un signal de brume en se fondant sur la puissance du son. Dans certaines conditions atmosphériques, le son peut être perdu à une très courte distance du signal. Ces conditions peuvent varier dans un laps de temps très court. Les navigateurs ne doivent jamais supposer que le signal de brume ne fonctionne pas du fait qu’ils ne l’entendent pas, même lorsqu’ils sont dans son voisinage immédiat.
- Les aides visuelles à la navigation fournies par la Garde côtière ont pour but de faciliter la navigation maritime. Les chasseurs, les motoneigistes et les pêcheurs sur glace doivent éviter de se fier aux aides à la navigation maritime après la fermeture de la saison de navigation. Les aides peuvent s’arrêter de fonctionner sans avertissement et ne seront pas remises en service par la Garde côtière canadienne avant l’ouverture de la saison de navigation suivante.
Amélioration continue
La Garde côtière canadienne vise constamment à réaliser des gains d’efficacité et des économies dans la prestation de service du Système canadien d’aides à la navigation. Dans certains cas, ces gains sont obtenus en utilisant et mettant en œuvre de nouveaux produits et technologies. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas limités à l’évolution dans l’utilisation des bouées fabriquées en plastique plutôt qu’en acier, de lanternes à DEL et d’aides électroniques. Les navigateurs sont avisés que tous les efforts possibles ont été déployés par la Garde côtière canadienne pour s’assurer que de nouveaux équipements fournissent des aides sécuritaires et fiables aux systèmes de navigation. En cas de problème ou de préoccupations, veuillez communiquer avec le surintendant, Aides à la navigation, de votre région.
Dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation
Loi sur les océans
Conformément à la Loi sur les océans (art. 41), les systèmes et services d’aide à la navigation, destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes, relèvent de la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Qu’est-ce qu’une aide à la navigation?
Le terme est défini à l’article 125 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
« aide à la navigation » signifie une bouée, une balise, un phare, un amer de terre, un appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime.
Toutes les aides à la navigation au Canada appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous le contrôle et la gestion du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (art. 128 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada).
Obligations importantes :
Dans le cas où un bâtiment – ou tout objet à sa remorque – renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne [paragraphe 129(1)].
Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne [paragraphe 129(2)].
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie [paragraphe 135(1)].
Code criminel du Canada
439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable
(a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
(b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le Code criminel est appliqué par la police.
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Le transport et l’utilisation de cartes et de publications nautiques sont régis par la section 6 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume publié par la Garde côtière canadienne est l’une des publications obligatoires. (Art. 142 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation).
Si le navire est muni d’un équipement radio, il doit transporter la publication Aides radio à la navigation maritime, également publié par la Garde côtière canadienne.
Le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation est géré et appliqué par le ministre des Transports.
Loi sur les eaux navigables canadiennes
Certaines aides à la navigation peuvent être considérées comme des ouvrages au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) et peuvent exiger l’application de l’une des procédures prévues par la loi avant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou la désaffectation dans, sur, au-dessus, au-dessous ou à travers toute eau navigable au Canada.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) est gérée et appliquée par le ministre des Transports par l’entremise du Programme de protection de la navigation.
Règlement sur les bouées privées
Qu’est-ce qu’une « bouée privée »?
Le terme se définit comme suit dans l’article 1 du Règlement sur les bouées privées, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada :
« bouée privée s’entend d’une bouée qui n’appartient ni à l’administration fédérale ni à une administration provinciale, ni à un organisme gouvernemental. »
Le Règlement sur les bouées privées décrit la taille, la couleur, la forme et les marques requises pour chaque bouée, ainsi que les responsabilités de la ou des personnes qui les mouillent, ainsi que les interdictions.
Il est interdit de mettre dans les eaux canadiennes une bouée privée qui nuit ou pourrait nuire à la navigation des navires ou qui induit en erreur ou pourrait induire en erreur les opérateurs de navire (article 3).
Le Règlement sur les bouées privées est géré et appliqué par le ministre des Transports qui a le pouvoir d’exiger la modification d’une bouée privée et peut faire enlever des eaux canadiennes toute bouée privée non conforme au présent règlement (article 7).
Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, décrit les restrictions en matière de navigation dans certaines eaux canadiennes intérieures et régit les marques de toute restriction en matière de navigation (p. ex. les limites de vitesse, les zones interdites, etc.).
Il est interdit d’installer une pancarte où que ce soit en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment dans les eaux canadiennes, sauf dans les cas suivants
(a) le ministre des Transports a autorisé l’installation de la pancarte et celle-ci est conforme au règlement;
(b) l’installation de la pancarte est autorisée sous le régime d’une loi fédérale (article 5).
Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments est géré et appliqué par le ministre des Transports.
Aides à la navigation de la Garde côtière canadienne
Les aides à la navigation de la Garde côtière canadienne consistent en toute aide à la navigation appartenant à la Garde côtière canadienne. Elles peuvent inclure toute aide à la navigation appartenant à une autre autorité gouvernementale assujettie à une entente entre la Garde côtière canadienne et cette autre autorité gouvernementale à condition que la Garde côtière canadienne en assume les responsabilités d’exploitation et d’entretien.
Les aides à la navigation de la Garde côtière canadienne et de certains autres gouvernements se distinguent des bouées privées par leur système particulier de codage avec des lettres et des numéros.
Aides à la navigation d’autres gouvernements
Des aides à la navigation d’autres gouvernements appartiennent à d’autres autorités gouvernementales qui en assument l’entière responsabilité en termes d’exploitation et d’entretien. Il peut s’agir d’organismes fédéraux, provinciaux ou autres, de ministères, de sociétés d’État ou d’autres autorités. À titre d’exemple, le ministère de la Défense nationale, Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les commissions des havres et ports et les sociétés de traversiers fournissent aussi des aides à la navigation gouvernementales.
Lorsque ces aides figurent sur des cartes, elles ne sont pas désignées par les lettres « PRIV » comme les autres aides privées.
Aides privées à la navigation
Généralités
Les particuliers, les clubs, les sociétés ou les autres groupes ont le droit d’installer des aides à la navigation ou des bouées d’amarrage à leurs fins personnelles. Ces aides sont connues sous le nom « d’aides privées » et sont aussi désignées dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume et sur les cartes marines. Les aides privées à la navigation sont définies comme étant les aides à la navigation ou les bouées d’amarrage qui ne sont pas exploitées par le gouvernement ou un organisme fédéral ou provincial. La Garde côtière canadienne considère toutes les aides appartenant à un gouvernement municipal comme privées.
La Garde côtière canadienne reconnaît la valeur de ces aides et leur contribution à la sécurité et au bien-être des plaisanciers. Il faut encourager une utilisation des aides privées conforme aux besoins locaux lorsque les aides de la Garde côtière canadienne ne sont pas justifiées par les politiques et directives actuelles.
Bouées privées
Toutes les bouées privées sont régies par le Règlement sur les bouées privées. Ce règlement stipule les exigences relatives aux marques, à la taille et à l’identification des bouées privées et exige qu’ils soient conformes à la présente publication. Le ministre des Transports est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’application du règlement, y compris l’enlèvement ou les consignes relatives à l’enlèvement ou à la modification des bouées privées non conformes. La Garde côtière canadienne est toujours chargée de la mise en œuvre, de la gestion et de l’application du Système canadien d’aides à la navigation et de toutes les autres publications techniques connexes.
Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec votre bureau local du Programme de protection de la navigation ou consulter la publication la plus récente de Transports Canada, Bouées privées – Guide du propriétaire (PDF, 885 Ko, disponible en format PDF seulement).
Aides fixes privées
Les aides fixes privées qui se trouvent dans des eaux navigables qui risquent de gêner légèrement ou sérieusement la navigation sont considérées comme des ouvrages en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC). Le ministre des Transports peut imposer n’importe quelles modalités et conditions en vue de l’approbation d’un ouvrage, incluant des feux, des marques et des bouées. La LENC confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner la modification et, si cet ordre n’est pas respecté, l’enlèvement de tout ouvrage qui n’a pas été approuvé, qui ne respecte pas la loi ou qui ne satisfait pas aux modalités et conditions de l’approbation.
Bouées d’amarrage privées
Transports Canada considère les bouées d’amarrage comme des « ouvrages » en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, étant donné qu’elles servent habituellement à amarrer des bâtiments à des lieux fixes (p. ex. quais, jetées ou appontements) et n’aident pas ou ne dirigent pas les navigateurs. Cela signifie que l’emplacement d’une bouée d’amarrage est assujetti aux procédures prévues par la loi pour les ouvrages.
Responsabilité
En cas d’accident impliquant une aide privée, la ou les personnes à qui appartient cette aide à la navigation peuvent être tenues responsables de tout dommage consécutif à une exploitation et(ou) un entretien négligent de l’aide. Il est conseillé aux propriétaires de prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que ces aides privées sont conformes aux normes internationales et à celles de la Garde côtière canadienne et sont exploitées et entretenues de manière appropriée. Il est recommandé de souscrire une assurance de responsabilité civile.
Marquages et dimensions
Aux termes du Règlement sur les bouées privées (RBP) établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toutes les bouées privées au Canada doivent être conformes aux normes afférentes à la navigation arrêtées par la loi. Bien que les exigences concernant la couleur, la forme, la mise à l’eau et l’utilisation de bouées privées soient identiques à celles des bouées entretenues par la GCC, les marques d’identification des bouées privées doivent être conformes au RBP et non au système d’identification alphanumérique utilisé par la GCC.
Le Règlement sur les bouées privées fixe les dimensions minimales de la partie émergée des bouées à 15,25 cm (6 pouces) de largeur et 30,5 cm (12 pouces) de hauteur. Ce sont là des minimums absolus qui ne peuvent convenir qu’à des endroits très abrités où la circulation est faible. De manière générale, une bouée doit être assez grande pour être vue à une distance telle que le navigateur pourra interpréter son signal et agir à temps, compte tenu des conditions météorologiques et de l’état de la mer. En vertu du Règlement sur les bouées privées, Transports Canada est habilité à exiger que les dimensions minimales soient dépassées, qu’un matériau rétroréfléchissant soit ajouté à la bouée ou qu’elle soit modifiée pour des raisons de sécurité (p. ex. ajout d’un feu, d’un dispositif sonore, etc.), selon les conditions qui prévalent à l’emplacement de la bouée.
Le Règlement sur les bouées privées exige aussi que les bouées portent les lettres majuscules « PRIV » sur deux côtés opposés. Ces lettres doivent être aussi grandes que la taille de la bouée le permet et de couleur contrastante : blanches si le fond est rouge, vert ou noir, ou noires si le fond est blanc ou jaune. De plus, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire actuel de la bouée doivent être inscrits d’une manière permanente et lisible.
Avis au public
Lorsqu’une aide privée est mouillée ou installée dans des eaux portées sur les cartes, il est souhaitable de fournir toute l’information nécessaire à la Garde côtière canadienne pour qu’elle puisse publier sa position et ses caractéristiques dans les avis maritimes (Avis aux navigateurs, Avertissement de navigation) et pour permettre au Service hydrographique du Canada de l’indiquer sur les cartes marines. De tels renseignements et toutes les modifications des aides indiquées sur les cartes actuelles doivent être transmis au bureau de la Garde côtière canadienne le plus proche ou à un centre de Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.
Caractéristiques des feux à éclats canadiens
Au Canada, toutes les aides à la navigation lumineuses, sauf celles qui sont munies d’un feu fixe (continu), ont un régime caractéristique d’éclats qui décrit leur rythme périodique et permet leur identification sur les cartes ou à vue.
Les caractéristiques d’un feu s’expriment par une suite de lettres et de chiffres qui décrivent les particularités de son fonctionnement. Voici un exemple de caractéristiques figurant dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume ou dans diverses publications de la Garde côtière canadienne :
Exemple :
Figure 1 : Exemple de caractéristiques d’un feu canadien composé d’un éclat de type Q(6), ainsi que d’éclats LFI supplémentaires sur une période de 15 secondes. Q est la série d’éclats et 6 est le groupe d’éclats.

Dans tous les cas, la ou les premières lettres des caractères représentent le type général d’éclat ou le classement. Ce classement est fondé sur la durée des périodes d’éclairage par rapport aux périodes d’éclipse (obscurité). Dans l’exemple, la lettre « Q » indique un feu à éclats en séquence rapide, c’est-à-dire un feu qui émet un éclat par seconde.
Lorsqu’un feu émet des éclats groupés, le deuxième symbole indique le nombre d’éclats composant le groupe. Dans ce même exemple, le « (6) » indique que les éclats sont émis par groupes de 6. Lorsque l’aide émet un éclat unique isolé, aucune valeur n’est indiquée.
Si la série comprend des éclats supplémentaires, ceux-ci sont indiqués par un « + » suivi du symbole d’un éclat ou d’un groupe d’éclats. Dans l’exemple illustré, le groupe des feux à éclats en séquence rapide (Q) de six éclats (6) est suivi d’un éclat long (+LFl).
Le dernier nombre des caractéristiques d’un feu à éclats représente la période au cours de laquelle la série complète d’éclats se produit, comme l’indique l’exemple plus haut. Ainsi, la caractéristique indique que toute la série d’éclats est répétée toutes les 15 secondes ou 4 fois par minute.
Une fois toutes les caractéristiques du feu relevées, le navigateur doit être en mesure d’identifier correctement le feu (comme l’exemple qui montre les caractéristiques du feu à éclats d’une bouée cardinale sud).
Aides flottantes à la navigation (bouées)
Le système de balisage utilisé au Canada correspond au système de balisage maritime de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM) qui a été adopté par tous les principaux pays maritimes du monde. Ce système comporte des bouées latérales, cardinales, de danger isolé et spéciales.
Pour les bouées latérales, le système de balisage maritime de l’AISM divise le monde en deux régions, « A » et « B ». Dans la Région « B », qui comprend le Canada, les bouées de tribord sont rouges et les bouées de bâbord sont vertes. Dans la Région « A », l’application de ces couleurs est inversée : rouge pour bâbord et vert pour tribord. La situation est similaire pour les bouées de bifurcation : la couleur prédominante de la bouée de tribord est rouge dans la Région « B » et verte dans la Région « A », et celle de la bouée de bâbord est verte dans la Région « B » et rouge dans la Région « A ». Toutes les autres caractéristiques du système de balisage maritime de l’AISM sont identiques dans les deux régions.
Étant donné que la forme et/ou la couleur de la bouée de même que les couleurs et les caractéristiques du feu surmontant la bouée en indiquent la fonction, il est essentiel que les navigateurs utilisent, avec ce système, des cartes de navigation à jour. Une description détaillée suit. En complément, consulter le Guide de référence rapide (horizontal) (PDF, 1,95 Mo, disponible en format PDF seulement) (Carte) du Système canadien d’aides à la navigation 2023.
Bouées latérales
Les bouées latérales indiquent le côté sur lequel il est possible de passer en toute sécurité. Il existe cinq types de bouées latérales :
- bouée de mi-chenal,
- bouée de bâbord,
- bouée de tribord,
- bouée de bifurcation de bâbord et
- bouée de bifurcation de tribord.
Ces aides ont des numéros d’identification et/ou des lettres qui augmentent au fur et à mesure que l’on progresse vers l’intérieur des terres et diminuent au fur et à mesure que l’on progresse vers les eaux libres.
Bouée de mi-chenal
Une bouée de mi-chenal marque une zone d’eaux sécuritaires. Elle est utilisée pour marquer des atterrages, l’entrée ou le milieu des chenaux. Elle doit être laissée sur bâbord (à gauche) dans les deux directions, car cela permet au navire de rester du bon côté du chenal.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur rouge et blanc en larges bandes verticales de largeur égale.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu « A » en code Morse Mo(A)6s ou en un feu à éclats longs (LFI)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est sphérique.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est une seule sphère rouge.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée de bâbord
Une bouée de bâbord marque le côté bâbord (gauche) d’un chenal ou l’emplacement d’un danger à laisser sur bâbord (à gauche) lorsque le navire se dirige vers l’amont.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et/ou un numéro impair et est de couleur verte.
- Si elle porte un feu, ce feu est vert et consiste en un feu à éclats (Fl)4s ou en un feu à éclats en séquence rapide (Q)1s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est cylindrique (plat).
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est vert.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul cylindre vert.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON.
En résumé :

Bouée de tribord
Une bouée de tribord marque le côté tribord (droit) d’un chenal ou l’emplacement d’un danger à laisser sur tribord (à droite) lorsque le navire se dirige vers l’amont.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et/ou un numéro pair et est de couleur rouge.
- Si elle porte un feu, ce feu est rouge et consiste en un feu à éclats (Fl)4s ou en un feu à éclats en séquence rapide (Q)1s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est conique (pointue).
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est rouge.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul cône rouge pointant vers le haut.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON.
En résumé :

Bouées de bifurcation
Une bouée de bifurcation marque le point d’embranchement d’un chenal et indique le chenal préféré ou le chenal principal lorsqu’elle est observée d’un navire se dirigeant vers l’amont.
Bouée de bifurcation de bâbord
Si l’on souhaite emprunter le chenal préféré (principal), cette bouée doit être laissée sur bâbord (à gauche).
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur verte avec une large bande horizontale rouge.
- Si elle porte un feu, ce feu est vert et consiste en un feu à éclats groupés composés Fl(2+1)6s ou Fl(2+1)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est cylindrique (plat).
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est vert.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul cylindre vert.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée de bifurcation de tribord
Si l’on souhaite emprunter le chenal préféré (principal), cette bouée doit être laissée sur tribord (à droite).
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur rouge avec une large bande horizontale verte.
- Si elle porte un feu, ce feu est rouge et consiste en un feu à éclats groupés composés Fl(2+1)6s ou Fl(2+1)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est conique (pointue).
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est rouge.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul cône rouge pointant vers le haut.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouées cardinales
Les bouées cardinales indiquent l’emplacement des eaux les plus sécuritaires ou les plus profondes par rapport aux points cardinaux sur la boussole. Il y a quatre bouées cardinales : nord, est, sud et ouest.
Bouée cardinale nord
Une bouée cardinale nord est une bouée au nord de laquelle les eaux sont les plus sécuritaires.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur noir et jaune en proportions à peu près égales au-dessus de la ligne de flottaison, la partie supérieure étant noire et la partie inférieure étant jaune.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu à éclats en séquence rapide (Q)1s ou en un feu à éclats en séquence très rapide (VQ)0,5s.
- Si elle ne porte pas de feu, la bouée est normalement en forme d’espar, bien que d’autres formes puissent être utilisées.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est deux cônes noirs superposés et pointant vers le haut.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée cardinale est
Une bouée cardinale est une bouée à l’est de laquelle les eaux sont les plus sécuritaires.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur noire avec une large bande horizontale jaune.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu à trois éclats groupés en séquence rapide Q(3)10s ou en un feu à trois éclats en séquence très rapide groupés VQ(3)5s.
- Si elle ne porte pas de feu, la bouée est normalement en forme d’espar, bien que d’autres formes puissent être utilisées.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est deux cônes noirs superposés et opposés par la base.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée cardinale sud
Une bouée cardinale sud est une bouée au sud de laquelle les eaux sont les plus sécuritaires.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur noir et jaune en proportions à peu près égales au-dessus de la ligne de flottaison, la partie supérieure étant jaune et la partie inférieure étant noire.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu à six éclats groupés en séquence rapide suivis d’un éclat long (Q(6)+LFI)15s ou en un feu à six éclats en séquence très rapide groupés suivis d’un éclat long (VQ(6)+LFI)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est la bouée est normalement en forme d’espar, bien que d’autres formes puissent être utilisées.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est deux cônes noirs superposés et pointant vers le bas.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée cardinale ouest
Une bouée cardinale ouest est une bouée à l’ouest de laquelle les eaux sont les plus sécuritaires.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur jaune avec une large bande horizontale noire.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu à neuf éclats groupés en séquence rapide Q(9)15s ou en un feu à neuf éclats en séquence très rapide groupés VQ(9)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est la bouée est normalement en forme d’espar, bien que d’autres formes puissent être utilisées.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est deux cônes noirs superposés et opposés par la pointe.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouées de danger isolé
Une bouée de danger isolé est amarrée sur ou à proximité d’un danger entouré d’eau navigables sécuritaires. Les aides de danger isolé peuvent être des bouées ou des balises. Toutefois, la forme prédominante utilisée dans le système canadien est la bouée.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur noire avec une large bande horizontale rouge.
- Si elle porte un feu, ce feu est blanc et consiste en un feu à éclats groupés Fl(2)5s ou Fl(2)10s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est normalement en forme d’espar, bien que d’autres formes puissent être utilisées.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est blanc.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est deux sphères noires superposées.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouées spéciales
Les bouées spéciales servent à transmettre des renseignements spécifiques au navigateur. Ces bouées n’ont pas pour but principal de guider la navigation du bâtiment. Les formes des bouées spéciales n’ont pas de signification en elles-mêmes et diverses formes peuvent être utilisées.
Un grand nombre de bouées spéciales sont privées et, à ce titre, elles doivent être conformes au Règlement sur les bouées privées.
Toutes les bouées spéciales, lorsqu’elles sont lumineuses, émettent des feux jaunes. À l’exception des bouées du Système d’acquisition de données océaniques (SADO), ces feux sont à éclats (Fl)4s, ce qui signifie que le feu émet régulièrement un éclat à 4 secondes d’intervalle. Les bouées du SADO, si elles sont lumineuses, portent également des feux jaunes, mais leurs caractéristiques sont Fl(5)20s, c’est-à-dire 5 éclats groupés toutes les 20 secondes.
Lorsqu’une bouée spéciale est munie d’un matériau rétroréfléchissant, la couleur de ce matériau est jaune. De plus, lorsqu’une bouée porte un symbole orange (p. ex. bouées d’obstacle), un matériau rétroréfléchissant orange peut être ajouté pour améliorer la visibilité du symbole. Si aucune couleur n’est exigée (p. ex. bouées de natation et de plongée blanches), le matériau rétroréfléchissant est jaune.
Remarque : Les bouées d’endroit interdit et de contrôle sont régies par le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB) établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les bouées du SADO et de plongée sont régies par le Règlement sur les abordages établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Bouée de mouillage
Une bouée de mouillage balise le périmètre d’une zone de mouillage désignée.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur jaune et porte le symbole d’une ancre noire sur au moins deux côtés opposés.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul voyant de la forme d’un « X » jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée d’avertissement
Une bouée d’avertissement balise une zone où les navigateurs doivent être avertis de la présence de dangers comme des zones de tir, de régates, des bases d’hydravions, des ouvrages sous-marins, des zones où il n’existe aucun chenal sûr, des zones de séparation de trafic et des exploitations d’aquaculture. Le navigateur doit consulter sa carte afin de déterminer la nature exacte du danger indiqué.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur jaune.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul voyant de la forme d’un « X » jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée de contrôle (Régie par le RRUB.)
Une bouée de contrôle balise une zone où la navigation est restreinte.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche avec le contour d’un cercle orange sur deux côtés opposés ainsi que deux bandes horizontales orange, au-dessus et au-dessous des cercles. Un nombre ou un symbole noir à l’intérieur des cercles orange indique la nature de la restriction en vigueur.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée de plongée
Une bouée de plongée signale une zone où des activités de plongée en scaphandre autonome ou autres sont en cours. Ne figure normalement pas sur les cartes.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche et porte un drapeau carré rouge dont chaque coté mesure au moins 50 centimètres de long, traversé en diagonale par une bande blanche allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : sans objet.
En résumé :

Bouée d’obstacle
Une bouée d’obstacle sert à baliser des obstacles épars comme des rochers, des hauts-fonds ou des eaux turbulentes situées en dehors du chenal principal.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche et porte le contour d’un losange orange sur deux côtés opposés ainsi que deux bandes horizontales orange, au-dessus et au-dessous des losanges. Les mots ou les symboles informant de l’obstacle sont inscrits à l’intérieur du losange ou, faute de place, entre les bandes orange.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : AIS AtoN, RACON
En résumé :

Bouée de renseignements
Une bouée de renseignements présente, à l’aide de mots ou de symboles, des renseignements d’intérêt pour le navigateur.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche et porte le contour d’un carré orange sur deux côtés opposés ainsi que deux bandes horizontales orange, au-dessus et au-dessous des carrés. Les mots ou symboles sont noirs et placés à l’intérieur de la face blanche du carré.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Équipement(s) Supplémentaire(s) (le cas échéant) : sans objet.
En résumé :

Bouée d’endroit interdit (Régie par le RRVUB.)
Une bouée d’endroit interdit balise une zone interdite aux embarcations.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche et porte, sur deux côtés opposés, un losange orange contenant une croix de couleur orange et deux bandes horizontales orange, l’une au-dessus et l’autre au-dessous des losanges.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
En résumé :

Bouée d’amarrage
Une bouée d’amarrage sert à amarrer ou à immobiliser un navire, un hydravion, etc.
- Elle peut montrer une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanc et orange, l’orange couvrant le tiers supérieur de la bouée au-dessus de la ligne de flottaison.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
En résumé :

Bouée SADO (Régie par le Règlement sur les abordages.)
Une bouée du Système d’acquisition de données océaniques (SADO) signale une station scientifique, météorologique ou océanographique. Elle ne doit pas avoir une forme que l’on pourrait confondre avec celle d’une marque servant à la navigation.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur jaune.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats groupés Fl(5)Y 20s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est un seul voyant à la forme d’un « X » jaune.
En résumé :

Bouée de natation
Une bouée de natation balise le périmètre d’une zone réservée à la natation. Elle peut ne pas être représentée sur les cartes.
- Elle montre une ou plusieurs lettres d’identification et est de couleur blanche. Les lettres d’identification sont facultatives.
- Si elle porte un feu, ce feu est jaune et consiste en un feu à éclats (FI)4s.
- Si elle ne porte pas de feu, le dessus de la bouée est de diverses formes possibles.
- Si elle porte un matériau rétroréfléchissant, ce matériau est jaune.
- Si elle porte un voyant, ce voyant est sans objet.
En résumé :

Identification de jour
Durant le jour, la couleur et la forme d’une bouée en indiquent le type ainsi que la fonction et la signification que le navigateur doit lui donner.
Couleur de la bouée
Voici les couleurs des bouées utilisées dans le Système de balisage canadien :
| Type de bouée | Couleur | Illustration |
|---|---|---|
| Mi-chenal | Bandes verticales rouges et blanches |  |
| Bâbord | Verte | 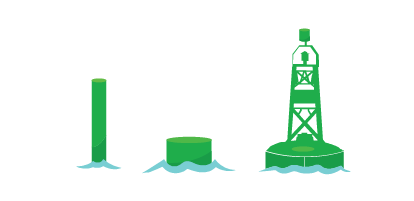 |
| Tribord | Rouge |  |
| Bifurcation de bâbord | Verte avec une bande horizontale rouge | 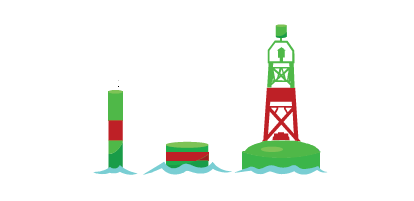 |
| Bifurcation de tribord | Rouge avec une bande horizontale verte | 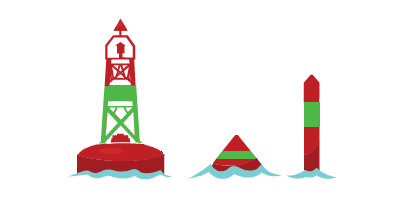 |
| Cardinale nord | Partie supérieure noire, partie inférieure jaune | 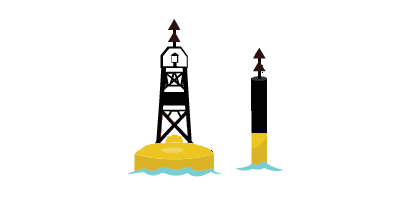 |
| Cardinale est | Noire avec une large bande horizontale jaune |  |
| Cardinale sud | Partie supérieure jaune, partie inférieure noire |  |
| Cardinale ouest | Jaune avec une large bande horizontale noire | 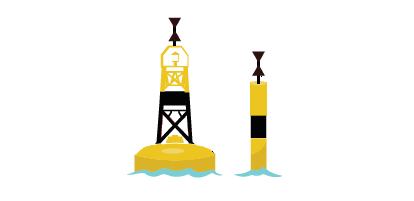 |
| Danger isolé | Noire avec une large bande horizontale rouge |  |
| Mouillage | Jaune |  |
| Avertissement | Jaune |  |
| SADO | Jaune | 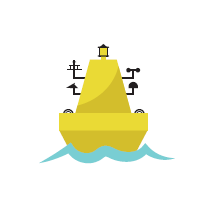 |
| Amarrage | Blanche avec des symboles orange |  |
| Zone interdite | Blanche avec des symboles orange |  |
| Contrôle | Blanche avec des symboles orange | 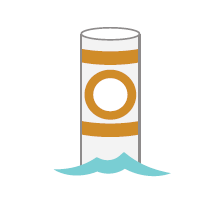 |
| Danger | Blanche avec des symboles orange | 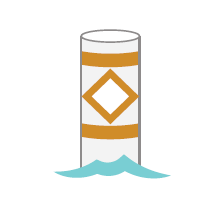 |
| Renseignements | Blanche avec des symboles orange |  |
| Natation | Blanche |  |
| Plongée | Blanche surmontée d’un drapeau rouge et blanc | 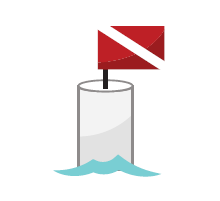 |
Forme de la bouée
La forme des bouées non lumineuses indique la position de la bouée par rapport au chenal et, par conséquent, le côté sur lequel il faut la laisser :
Une bouée de forme conique (pointue) balise le côté tribord (droit) du chenal ou de l’emplacement d’un danger qu’il faut laisser sur tribord (à droite) en se dirigeant vers l’amont.

Une bouée de forme cylindrique (plat) balise le côté bâbord (gauche) du chenal ou de l’emplacement d’un danger qu’il faut laisser sur bâbord (à gauche) en se dirigeant vers l’amont. Une bouée à dessus plat (cylindrique) peut aussi être utilisée à d’autres fins pour lesquelles la forme n’est pas signifiante (par exemple, une bouée spéciale et une bouée cardinale). Le mouillage d’une telle bouée doit être fait avec soin afin d’éviter qu’une interprétation, basée seulement sur la forme, ne crée une situation dangereuse.

Une bouée de forme sphérique balise le centre du chenal ou des eaux sécuritaires et signifie qu’il est possible de la laisser en toute sécurité sur un côté ou sur l’autre même s’il conviendrait, en règle générale, de la laisser sur bâbord (à gauche), que l’on se dirige vers l’amont ou vers l’aval.

Voyants
En raison des conditions environnementales auxquelles sont soumises les aides à la navigation canadiennes, les voyants ne sont pas autant utilisés que dans d’autres régions du monde. Durant le jour, l’usage de voyants à titre de moyen additionnel d’identification des bouées se limite principalement aux bouées latérales, aux bouées cardinales et aux bouées de danger isolé situées dans les eaux libres de glace. Il est conseillé aux navigateurs de ne pas se fier uniquement aux voyants pour identifier la bouée, car ils sont susceptibles d’être endommagés et ils peuvent être enlevés intentionnellement en hiver ou s’il y a formation de glace.
Lorsqu’ils sont posés, le Système de balisage canadien prévoit des voyants pour chaque bouée :
| Type de bouée | Description du voyant | Illustration |
|---|---|---|
| Mi-chenal | Une seule sphère rouge |  |
| Bâbord et bifurcation de bâbord | Un seul cylindre vert |  |
| Tribord et bifurcation de tribord | Un seul cône rouge pointant vers le haut |  |
| Cardinale nord | 2 cônes noirs pointant vers le haut |  |
| Cardinale est | 2 cônes noirs opposés par la base |  |
| Cardinale sud | 2 cônes noirs pointant vers le bas |  |
| Cardinale ouest | 2 cônes noirs opposés par la pointe |  |
| Danger isolé | 2 sphères noires superposées |  |
Conseil : Un moyen permettant de se rappeler la disposition des voyants coniques sur les bouées cardinales consiste à établir un lien entre la direction des pointes des cônes et la section occupée sur la bouée par la partie noire. Par exemple, sur une bouée cardinale est, le cône supérieur pointant vers le haut et le cône inférieur pointant vers le bas ont un lien avec la partie supérieure et la partie inférieure noires de la bouée.

Identification de nuit
La nuit, la couleur et les caractéristiques du feu d’une bouée indiquent sa fonction. Si elle n’est pas éclairée, un matériau rétroréfléchissant peut être appliqué.
Caractéristiques des feux à éclats des bouées
Des feux de différentes couleurs sont utilisés pour faciliter la reconnaissance des marques du Système canadien d’aides à la navigation : des feux verts et rouges pour les bouées latérales, des feux blancs pour les bouées cardinales, de danger isolé et de mi-chenal, et des feux jaunes pour les bouées spéciales.
Les caractéristiques du feu de toutes les bouées dans le Système canadien d’aides à la navigation doivent être conformes aux « Spécifications des caractéristiques des feux de bouée » détaillées ci-dessous. La principale caractéristique sera utilisée dans tous les cas à l’exception de :
- lorsqu’une distinction est nécessaire entre deux bouées identiques qui sont à proximité l’une de l’autre; ou
- lorsqu’il faut indiquer qu’une attention particulière est requise (par exemple, l’utilisation de la deuxième caractéristique « à éclats en séquence rapide » pour différencier les bouées marquant un tournant dans un système de bouées latérales); ou
- lorsque les besoins d’une plus grande perception l’exigent ou pour améliorer la disponibilité du feu dans des conditions de vagues plus tumultueuses.
Voici les noms, les abréviations et les descriptions des caractéristiques des feux utilisés dans le Système de balisage canadien :
Mi-chenal
Principale : code Morse A – Mo(A)6s

Un feu blanc dont l’éclat de 0,3 seconde est suivi d’une éclipse de 0,6 seconde, puis d’un éclat long régulier d’une seconde, à une fréquence de 10 fois par minute (toutes les 6 secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,6 sec.
- Éclat de 1,0 sec.; éclipse de 4,1 sec.
Secondaire : à éclats longs – (LFl)10s

Un feu blanc dont la durée de l’éclat de 2 secondes est répété à une fréquence de 6 éclats par minute (1 éclat long toutes les 10 secondes).
- Éclat de 2,0 sec.; éclipse de 8,0 sec.
Bâbord et tribord
Principale : à éclats – (Fl)4s

Un feu (rouge pour tribord et vert pour bâbord) dont la durée totale d’éclat dans une période est inférieure à la durée d’éclipse et dont les éclats sont répétés régulièrement à une fréquence de 15 éclats par minutes (un éclat toutes les 4 secondes).
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 3,5 sec.
Secondaire : à éclats en séquence rapide – (Q)1s

Un feu (rouge pour tribord et vert pour bâbord) dont les éclats identiques sont répétés à une fréquence de 60 éclats par minute (un éclat par seconde).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
Bifurcation
Principale : à éclats groupés composés Fl(2+1)6s

Un feu (rouge pour tribord et vert pour bâbord) pour lequel un groupe de 2 éclats est suivi d’un seul éclat, la séquence complète étant répétée 10 fois par minute (toutes les 6 secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,4 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 1,2 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 3,5 sec.
Secondaire : À éclats groupés composés – Fl(2+1)10s

Un feu (rouge pour tribord et vert pour bâbord) pour lequel un groupe de 2 éclats est suivi d’un seul éclat, la séquence complète étant répétée 6 fois par minute (toutes les 10 secondes).
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 2,1 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 5,7 sec.
Cardinale nord
Principale : à éclats en séquence rapide – (Q)1s

Un feu blanc dont les éclats identiques sont répétés à une fréquence de 60 éclats par minute (1 éclat toutes les secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
Secondaire : à éclats en séquence très rapide – (VQ).5s

Un feu blanc dont l’éclat est répété à une fréquence de 120 éclats par minute (1 éclat toutes les 0,5 seconde).
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
Cardinale est
Principale : à éclats groupés en séquence rapide – Q(3)10s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 3 éclats est répété à une fréquence de 6 fois par minute (toutes les 10 secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 7,7 sec.
Secondaire : à éclats groupés en séquence très rapide – VQ(3)5s

Un feu blanc à éclats en séquence très rapide pour lequel un groupe de 3 éclats est répété à une fréquence de 12 fois par minute (toutes les 5 secondes).
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 3,8 sec.
Cardinale sud
Principale : à éclats groupés en séquence rapide + à éclats longs – (Q(6)+LFl)15s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 6 éclats rapides est suivi d’un seul éclat long, la séquence complète étant répétée 4 fois par minute (toutes les 15 secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 2,0 sec.; éclipse de 7,0 sec.
Secondaire : à éclats groupés en séquence très rapide + à éclats longs – (VQ(6)+LFl)10s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 6 éclats très rapides est suivi d’un seul éclat long, la séquence complète étant répétée 6 fois par minute (toutes les 10 secondes).
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 2,0 sec.; éclipse de 5,0 sec.
Cardinale ouest
Principale : À éclats groupés en séquence rapide – Q(9)15s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 9 éclats est répété 4 fois par minute (toutes les 15 secondes).
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 0,7 sec.
- Éclat de 0,3 sec.; éclipse de 6,7 sec.
Secondaire : à éclats groupés en séquence très rapide – VQ(9)10s

Un feu blanc à éclats en séquence très rapide pour lequel un groupe de 9 éclats est répété 6 fois par minute (toutes les 10 secondes).
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 0,3 sec.
- Éclat de 0,2 sec.; éclipse de 5,8 sec.
Danger isolé
Principale : à éclats groupés – Fl(2)5s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 2 éclats est répété à une fréquence de 12 fois par minute (toutes les 5 secondes).
- Éclat de 0,4 sec.; éclipse de 0,6 sec.
- Éclat de 0,4 sec.; éclipse de 3,6 sec.
Secondaire : à éclats groupés – Fl(2)10s

Un feu blanc pour lequel un groupe de 2 éclats est répété à une fréquence de 6 fois par minute (toutes les 10 secondes).
- Éclat de 1,0 sec.; éclipse de 1,0 sec.
- Éclat de 1,0 sec.; éclipse de 7,0 sec.
Conseil : Un moyen permettant de se rappeler les caractéristiques du feu des bouées cardinales est, sud et ouest consiste à faire correspondre le nombre d’éclats de chaque groupe, dans le cas de ces feux, aux chiffres d’une horloge équivalant à la direction correspondante sur le compas. Par exemple, les 3 éclats de chaque groupe dans le cas de la bouée cardinale est correspondent à trois heures. L’éclat prolongé de la bouée cardinale sud vise à éviter la confusion entre les 6 éclats par groupe de cette bouée et les 9 éclats de la bouée cardinale ouest.

Spéciales (sauf celles du SADO)
À éclats – (Fl)4s

Un feu jaune dont l’éclat d’une durée plus brève que la période d’éclipse est répété à une fréquence de 15 éclats par minute (un éclat toutes les 4 secondes).
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 3,5 sec.
SADO (Système d’acquisition de données océaniques)
À éclats groupés – Fl(5)Y 20s

Un feu jaune pour lequel un groupe de 5 éclats est répété régulièrement 3 fois par minute (toutes les 20 secondes).
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 1,5 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 1,5 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 1,5 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 1,5 sec.
- Éclat de 0,5 sec.; éclipse de 11,5 sec.
Couleurs des feux des bouées
Couleurs des feux des bouées utilisées dans le Système de balisage canadien
| Type de bouée | Couleur du feu |
|---|---|
| Bâbord et bifurcation de bâbord |  |
| Tribord et bifurcation de tribord | 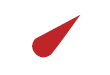 |
| Mi-chenal, danger isolé et toutes les bouées cardinales | 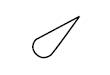 |
| Toutes les bouées spéciales | 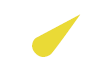 |
Matériau rétroréfléchissant
Un matériau rétroréfléchissant est appliqué sur les bouées non lumineuses, pour aider à les identifier la nuit au moyen d’une lampe de poche étanche à l’eau ou d’une autre source lumineuse, et sur les bouées lumineuses comme source lumineuse auxiliaire. Sauf dans le cas des bouées spéciales, la couleur du matériau rétroréfléchissant est identique à la couleur appropriée du feu de chaque bouée.
Lorsqu’une bouée spéciale a des chiffres, des lettres ou un fond revêtus d’un matériau rétroréfléchissant, la couleur du matériau est jaune. De plus, lorsqu’une bouée porte un symbole orange (par exemple, bouée d’obstacle), un matériau rétroréfléchissant orange peut être ajouté pour rehausser la visibilité du symbole.
Remarque : Pour les bouées de natation et de plongée, qui sont de couleur blanche, le matériau rétroréfléchissant est jaune.
Autres caractéristiques
Numérotation des bouées
Seules les bouées de tribord et de bâbord sont numérotées. Les bouées de tribord portent un nombre pair et les bouées de bâbord un nombre impair. Les numéros des bouées vont en augmentant lorsque le navire se dirige vers l’amont. Les bouées placées des deux côtés d’un chenal suivent une numérotation séquentielle, mais certains numéros peuvent être omis par endroit, au besoin. Les nombres sont habituellement précédés d’une ou de deux lettres pour faciliter l’identification du chenal.
Tous les autres types de bouées sont identifiées uniquement par des lettres. Par ailleurs, tous les types de bouée peuvent être identifiés par un nom s’ajoutant à un nombre ou à une lettre. Les bouées privées ne portent ni nombre ni lettre, étant donné qu’elles n’appartiennent pas au gouvernement. Elles affichent les lettres « PRIV » et toute autre information nécessaire selon le Règlement sur les bouées privées.
Signaux sonores
Chaque type de bouée du Système de balisage canadien peut être doté d’une cloche ou d’un sifflet activé par le mouvement de la bouée dans l’eau. Ces bouées ne servent généralement que dans les eaux côtières où la bouée bouge suffisamment pour activer le dispositif sonore et où un signal sonore est nécessaire pour permettre la localisation de la bouée quand la visibilité est mauvaise.
Remarque : Avec l’amélioration des systèmes électroniques de navigation et les progrès technologiques, les aides sonores traditionnelles ne sont plus considérées comme des aides à la navigation efficaces.
Réflecteurs radar
De nombreuses bouées sont dotées de réflecteurs radar qui améliorent leur visibilité sur l’écran radar.
Balises radar (RACON)
Lorsqu’il est essentiel de pouvoir identifier une bouée avec exactitude, cette bouée peut être dotée d’une balise radar (RACON). La partie 2 de la publication Aides radio à la navigation maritime dresse une liste exhaustive des RACON avec des renseignements comme le nom et l’emplacement, la portée, l’arc et l’identificateur (code morse). La publication Livre des feux, des bouées et des signaux de brume fournit également certains renseignements sur les RACON.
Marquage de nouveaux dangers
De nouveaux dangers, comme une épave ou la découverte d’un haut-fond ou d’un rocher non indiqués sur les cartes, peuvent apparaître de façon soudaine et inattendue dans des eaux que les navigateurs ont pris l’habitude de considérer comme sécuritaires. Le Système canadien de balisage prévoit les mesures spéciales suivantes pour ces dangers :
- Le premier choix pour marquer un nouveau danger est l’aide de danger isolé ancrée ou installée au-dessus du danger. Des bouées latérales, des aides cardinales ou des bouées d’avertissement peuvent également être utilisées.
- Une ou plusieurs des aides marquant le nouveau danger peuvent être dupliquées, ces bouées supplémentaires étant identiques en tous points à la bouée qu’elles dupliquent
- En général, le feu de toute aide lumineuse latérale ou cardinale servant à baliser un nouveau danger doit avoir la caractéristique d’éclat la plus rapide pour cette aide.
- Un nouveau danger peut être marqué par une balise radar (RACON) codée « D » ( – ● ● ) en morse.
- Les mesures spéciales prises pour baliser un nouveau danger peuvent être suspendues lorsque des renseignements concernant ce danger ont reçu une diffusion suffisante.
Aides fixes à la navigation
Généralités
Les aides fixes ont des caractéristiques qui permettent de les identifier. Elles consistent en la couleur du feu, les caractéristiques des éclats et la couleur et la forme de l’ouvrage, comme annoncés dans la publication Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.
Aides fixes lumineuses
Généralités
Les aides fixes lumineuses sont des ouvrages munis d’un feu et placés à des endroits stratégiques afin d’aider le navigateur à déterminer sa position. Elles peuvent être situées sur la côte ou à proximité, ou sur des piliers construits dans ou près des voies navigables. La ou les couleurs et le type de structure sont souvent choisis pour assurer le maximum de visibilité et faciliter leur identification, et peuvent ou non avoir une signification latérale.
Types
Au Canada, les ouvrages lumineux fixes possèdent des styles très variés. Ils peuvent avoir des parois verticales ou en biseau, mais aussi être de forme circulaire, carrée, polygonale ou octogonale et être construits en bois, en maçonnerie, en béton, en métal ou en fibre de verre. Ils peuvent prendre la forme de simples structures cylindriques, minces comme des tuyaux ou des poteaux, ou des tours à claire-voie.
Les aides lumineuses primaires sont des feux d’atterrage côtiers dotés de caractéristiques particulières pour aider le navigateur à déterminer son emplacement exact.
Les aides lumineuses secondaires sont des marques fixes qui indiquent la position des dangers ou avertissent de leur existence. Habituellement, les aides lumineuses secondaires qui portent une bande rouge, verte ou noire, ou une marque de jour, comportent également des indications concernant le côté où il faut passer. Les aides lumineuses secondaires qui portent des bandes rouges doubles prévoient un atterrage secondaire. Lorsque ces aides d’atterrage secondaires sont également utilisées pour indiquer de quel côté il faut passer, une marque de jour latérale (par exemple, un carré vert – bâbord) sera ajoutée entre les deux bandes rouges.
Remarque : Voir le guide de référence rapide (horizontal) (PDF, 1,95 Mo, disponible en format PDF seulement) ou la vidéo du Système canadien d’aides à la navigation pour plus d’explications sur ces types.
Les aides cardinales indiquent l’emplacement des eaux les plus sécuritaires ou les plus profondes par rapport aux points cardinaux sur la boussole. Il y a quatre aides cardinales : nord, est, sud et ouest. Se reporter à la section des aides cardinales pour les caractéristiques, car elles sont similaires à celles des bouées cardinales.
Les aides de danger isolé peuvent être des bouées ou des balises. Toutefois, la forme prédominante utilisée dans le système canadien est la bouée. Elles sont amarrées au-dessus d’un danger isolé qui est entouré d’eaux navigables sécuritaires. Elles sont noires avec une large bande horizontale rouge et portent une ou plusieurs lettres d’identification. Pour obtenir de plus amples détails, se reporter à la section ‘Bouées de danger isolé’.
Signification latérale
Les navires se dirigeant vers l’amont doivent laisser sur tribord (à droite) les aides fixes portant un triangle rouge au centre de la marque de jour ou une bande rouge au sommet de la tour. Ils doivent laisser sur bâbord (à gauche) les aides fixes portant un carré noir ou vert au centre de la marque de jour, ou une bande verte ou noire au sommet de la tour.
Les aides fixes arborant un losange blanc au pourtour rouge au centre de la marque de jour indiquent une division de chenal et il est possible de les laisser d’un côté ou de l’autre. En revanche, lorsque le navire se dirige vers l’amont, un triangle rouge au centre du losange rouge indique que la route préférée est à gauche (c.-à-d. que l’aide doit être maintenue sur le côté tribord [à droite] du navire). De même, un carré noir ou vert au centre du losange rouge indique que la route préférée est à droite (c.-à-d. que l’aide doit être maintenue sur le côté bâbord [à gauche] du navire).
Classement des feux
On trouvera ci-après les noms, les abréviations (telles qu’elles apparaissent sur les cartes marines) et les descriptions des catégories principales des phares canadiens :
Fixe (F)
La lumière apparaît en continuelle

Isophase (Iso)
Feu dont les périodes de lumière et les périodes d’obscurité se succèdent et sont d’égale longueur. p. ex. Iso

À éclats (Fl)
Les périodes d’éclairage sont nettement plus courtes que les périodes d’obscurité (éclipses) et les éclats sont tous d’égale durée.
Feu à éclats unique, p. ex. Fl

Feu à éclats longs, p. ex. LFl

Feu à éclats groupés, p. ex. Fl(2)

Feu à éclats groupés composés, p. ex. Fl(2 + 1)

À occultations (Oc)
Les périodes de lumière sont nettement plus longues que les périodes d’obscurité (éclipses) et les intervalles d’obscurité sont tous d’égale durée.
Feu occultant unique, p. ex. Oc

Feu occultant groupé, p. ex. Oc(2)

Feu occultant groupé composé, p. ex. Oc(2+1)

Urgence auxiliaire (FI(6)15s)
Des groupes de 6 éclats se succèdent régulièrement à la fréquence de 4 par minute (toutes les 15 secondes)
Rapide (Q)
Feu dont les éclats se répètent à une fréquence d’au moins 50 éclats par minute et de moins de 80 éclats par minute
Feu rapide continu, p. ex. Q

Feu rapide groupé, p. ex. Q(3)

Très rapide (VQ)
Feu très rapide dont les éclats se répètent régulièrement à une fréquence d’au moins 80 éclats par minute et de moins de 159 éclats par minute (habituellement soit 100 ou 120 éclats par minute) p. ex. VQ

p. ex. VQ(6)+LFl

Code Morse (Mo(A))
Feu dans lequel les apparitions de lumière de deux durées clairement différentes sont regroupées pour représenter un ou plusieurs caractères du code Morse.
p. ex. Mo(A)

La durée des périodes de lumière et d’obscurité varie selon les feux et est indiquée dans la publication appropriée du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume. Les navigateurs doivent savoir qu’un phare peut posséder plusieurs caractéristiques (p. ex. un éclat à forte intensité peut être superposé à un feu fixe). Il est par conséquent indispensable de consulter le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume pour bien identifier un feu.
Couleurs des feux
Pour une aide fixe, le choix de la couleur du feu dépend des conditions propres au lieu (présence d’un arrière-plan lumineux par exemple) et de la portée lumineuse de la couleur dans ces conditions. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune règle établie et que les navigateurs doivent toujours consulter la carte pour déterminer la fonction d’un feu.
Cependant, quelques lignes directrices peuvent être suivies :
- Les grands phares d’atterrage côtiers ont généralement un feu blanc,
- Les feux verts et rouges servent habituellement à indiquer de quel côté il faut passer (tribord et bâbord), et
- Les feux jaunes peuvent servir à signaler les endroits où la prudence est de rigueur.
Tout feu blanc, vert ou rouge peut passer au jaune sans avertissement lorsqu’un nouveau danger exige la prudence. C’est le cas, par exemple, lorsque l’envasement entraîne une réduction de la profondeur de l’eau, ce qui limite la sécurité de la navigation aux petites embarcations seulement.
Marques de jour et balises de jour
Une balise de jour est un ouvrage muni d’une marque de jour servant surtout à guider les navigateurs aux endroits où la navigation nocturne est presque inexistante, ou aux endroits où il est impossible de faire fonctionner un feu. Elles sont également appelées aides fixes non lumineuses. Des marques de jour peuvent également se trouver sur des aides lumineuses secondaires.
Les caractéristiques qui permettent aux navigateurs d’identifier la signification d’une marque de jour sont la couleur, la forme et parfois un numéro. Un matériau rétroréfléchissant et/ou fluorescent appliqué sur la marque de jour augmente sa visibilité de nuit et permet au navigateur de l’identifier au moyen d’un projecteur.
Une marque de jour est placée dans la direction dans laquelle le navigateur s’approche. Lorsqu’il est nécessaire de placer une marque de jour face à deux directions, les deux marques doivent alors être placées dos à dos ou de façon à ne pas modifier la forme de la marque ou l’apparence de la balise de jour vue de l’une ou l’autre de ces directions.
Balise de jour de bâbord
Une balise de jour de bâbord est munie d’une marque de jour de forme carrée qui comporte au centre un carré vert fluorescent ou noir sur fond blanc entouré d’une bordure rétroréfléchissante verte. Elle peut porter un chiffre impair fait de matériau blanc rétroréfléchissant. Un navire se dirigeant vers l’amont doit laisser sur bâbord (à gauche) une balise de jour de bâbord.

Balise de jour de tribord
Une balise de jour de tribord est munie d’une marque de jour de forme triangulaire et comporte au centre un triangle rouge fluorescent sur fond blanc entouré d’une bordure rétroréfléchissante rouge. Elle peut porter un chiffre pair fait de matériau blanc rétroréfléchissant. Un navire se dirigeant vers l’amont doit laisser sur tribord (à droite) une balise de jour de tribord.

Balise de jour de bifurcation
Une balise du jour de bifurcation est munie d’une marque de jour en forme de losange et marque un embranchement du chenal.
Elle peut être laissée d’un côté ou de l’autre.
- Lorsqu’un navire se dirige vers l’amont, une balise de jour de bifurcation présentant une marque de jour avec un carré vert rétroréfléchissant sur un losange blanc avec une bordure rouge fluorescente indique que la route préférée est à droite. En procédant en aval, la route préférée est à gauche.

- Lorsqu’un navire se dirige vers l’amont, une balise de jour de bifurcation présentant une marque de jour avec un triangle rouge rétroréfléchissant sur un losange blanc avec une bordure rouge fluorescente indique que la route préférée est à gauche. En procédant en aval, la route préférée est à droite.

Mouillage interdit
Une balise de jour de mouillage interdit est munie d’une marque de jour de forme carrée. Le symbole d’une ancre noire apparaît au centre sur un fond blanc rayé par une bande rouge diagonale fluorescente allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Ne pas jeter l’ancre dans la zone indiquée sur la carte. La zone peut contenir des pipelines submergés, des câbles électriques, etc.

Alignements
Un alignement est composé de deux structures, chacune munie d’une marque de jour fixe trapézoïdale. La marque de jour antérieure ressemble à la moitié inférieure d’un sablier et la marque de jour postérieure à la moitié supérieure d’un sablier. Ces marques de jour comportent une bande rouge, blanche ou noire verticale sur un fond blanc, rouge ou noir. Les alignements peuvent être lumineux ou non. S’ils sont lumineux, les couleurs des marques de jour d’alignement ainsi que les couleurs et les caractéristiques des feux sont annoncées dans la publication appropriée du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume. Dans certains cas, il est possible d’éclairer les alignements 24 heures par jour sans ajouter de marques de jour.

Aides sonores
Généralités
Les aides sonores sont des dispositifs émettant un son comme les bouées à cloche, les bouées à sifflet et les signaux de brume. Elles avertissent le navigateur d’un danger lorsque les aides visuelles sont obscurcies par des conditions de faible visibilité.
Remarque : Avec l’amélioration des systèmes électroniques de navigation et les progrès technologiques, les aides sonores traditionnelles ne sont plus considérées comme des aides à la navigation efficaces.
Fonctionnement
Habituellement, les aides sonores fonctionnent manuellementNote de bas de page 1 ou automatiquement par l’action des vagues lorsque la visibilité est réduite à moins de deux milles marins. Bien qu’elles soient fiables pour certains utilisateurs lorsque l’objectif de disponibilité de la visibilité ne peut être satisfait par le système conçu, elles peuvent seulement être utilisées pour signaler un danger, car elles ne sont pas considérées comme étant efficaces pour la navigation.
Si le besoin d’augmenter un système d’aide à la navigation avec des signaux sonores surgit, la propagation du son dans la zone doit être prise en considération dans le but de déterminer la meilleure aide sonore à utiliser.
Caractéristiques
Le navigateur peut identifier les aides sonores par leurs caractéristiques. Si une aide sonore figure dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume, ses caractéristiques et son orientation seront incluses; comme le montre l’exemple ci-bas.
Exemple de caractéristiques des aides sonores
Figure 2 : Exemple de caractéristiques des aides sonores du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

Description textuelle de la figure 2 : Exemple de caractéristiques des aides sonores du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume
- No : 6
- Numéro de référence international : H440
- Nom : Cape Pine
- Position : Sur le cap.
- Latitude N. : 46 37 01.1
- Longitude W. : 053 31 53.1
- Caractéristiques du feux :
- FI
- W
- 5s
- Hauteur focale en m. au-dessus de l’eau : 95.7
- Portée Nominale : 16
- Description : Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches.
- Hauteur en mètres au-dessus du sol : 18.4
- Remarques : Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d’année.
- Signaux de brume :
- Cornet - Son 4 s ; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 159°.
- Carte – 4842
Feux à secteurs
Généralités
Un feu à secteurs est un feu unique dont le faisceau lumineux est divisé en secteurs de différentes couleurs afin de donner un avertissement aux navigateurs ou de définir un alignement. Certains feux à secteurs ont un faisceau de couleur unique à ouverture limitée (voir l’illustration dans le Guide de référence rapide (PDF, 1,95 Mo, disponible en format PDF seulement) du Système canadien d’aides à la navigation). Le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume et les cartes marines indiquent les limites et les couleurs de ces secteurs. A noter qu’un secteur blanc indique la route la plus sécuritaire.
Types de feux à secteurs
Pour marquer la présence d’obstacles
Un secteur rouge seul à l’intérieur d’un faisceau lumineux blanc indique la présence d’obstacles comme des hauts-fonds.

Axe d’alignement
Une combinaison de secteurs rouges, blancs et verts dans un faisceau lumineux définit un axe d’alignement aux navigateurs. Pour un navire se dirigeant vers l’amont, le secteur rouge indique la limite à tribord, le blanc, la route à suivre, et le vert, la limite à bâbord.

Avec limites oscillantes
Certains feux à secteurs sont parfois équipés d’un dispositif de limites oscillantes. Des « secteurs limites » supplémentaires peuvent ainsi être créés entre les faisceaux unis. Dans ces secteurs limites, le rythme des couleurs qui alternent donne à l’observateur une indication visuelle de sa position.

Application
L’application la plus courante d’un feu à secteurs est le feu tricolore (rouge/blanc/vert) qui définit un axe d’alignement. Cependant, le navigateur doit consulter la carte et d’autres publications pour interpréter et utiliser correctement chaque feu. Sans égard à l’orientation des couleurs, le symbole des cartes (l’abréviation) pour un feu à secteurs tricolore est toujours RWG (rouge/blanc/vert).
Par exemple, à bord d’un navire se dirigeant vers l’amont et traversant, de gauche à droite, le faisceau d’un feu à secteurs tricolore avec limites oscillantes, l’observateur verrait, dans l’ordre :
- G
- Vert uni
- AIGW
- Les feux vert et blanc sont en alternance toutes les trois (3) secondes. La durée du feu blanc est brève lorsque le navigateur entre au début des limites du secteur, mais devient progressivement plus longue au fur et à mesure que le navigateur traverse vers la limite du secteur blanc uni.
- W
- Blanc uni
- AIRW
- Les feux rouge et blanc sont en alternance toutes les trois (3) secondes. La durée du feu rouge est brève lorsque le navigateur entre au début des limites du secteur, mais devient progressivement plus longue au fur et à mesure que le navigateur traverse vers la limite du secteur rouge uni.
- R
- Rouge uni
Aides électroniques à la navigation
Aides à la navigation du système d’identification automatique (AIS AtoN)
Une aide à la navigation du système d’identification automatique (AIS AtoN) est une aide à la navigation numérique diffusée par un fournisseur de services autorisé, utilisant le message AIS 21 (Rapport d’aide à la navigation) et qui peut s’afficher sur des équipements de navigation embarqués ou terrestres configurés tels que le système électronique de visualisation de cartes marines (SEVCM), le radar, ou un système intégré de navigation (SIN). Elle est utilisée pour compléter les aides à la navigation et les systèmes d’aide existants, dans les situations où la mise en place d’une aide physique n’est pas pratique, ou dans des circonstances particulières, tels que les zones de ralentissement saisonnier. Les AIS AtoN fournissent aux navigateurs un moyen d’identification positif et utilisable par tous les temps.
Les types d’AIS AtoN suivants peuvent être utilisés au Canada :
- Une AIS AtoN physique est basée sur un signal transmis par une aide à la navigation qui existe physiquement;
- Une AIS AtoN virtuelle est basée sur un signal transmis par une source autre qu’une aide à la navigation physique, indiquant une aide qui n’est affichée que sur l’équipement de navigation électronique et qui n’existe pas physiquement.
- Les AIS AtoN synthétiques sont un hybride des types physiques et virtuels. Elles sont transmises par des stations de l’AIS situées à une certaine distance d’une aide à la navigation physique. La variante surveillée comprend un lien de communication entre l’aide et la station, confirmant ainsi sa position, ce qui n’est pas le cas de la variante prédite.
Un numéro d’identification du service maritime mobile (ISMM) est attribué à chaque AIS AtoN.
Un symbole en forme de losange est utilisé pour représenter les signaux AIS AtoN sur les écrans de navigation électronique qui sont interfacés avec l’AIS. Les types physiques et synthétiques sont représentés par des lignes pleines, tandis que les types virtuels sont représentés par des lignes pointillées. De plus amples informations sur chaque aide apparaissent lorsque l’on interagit avec elles par l’intermédiaire d’un équipement de navigation électronique. Voir les figures suivantes pour des exemples.
Figure 3 : Symboles en forme de losange utilisés pour représenter un signal AIS AtoN

Description textuelle de la Figure 3: Symboles en forme de losange utilisés pour représenter un signal AIS AtoN
La forme de base d’un AIS AtoN réel ou synthétique est un losange, dont le contour est une ligne pleine épaisse, avec un signe plus au milieu.
La forme de base d’un AIS AtoN virtuel est un losange, dont le contour est tracé en pointillés épais, avec un signe plus au milieu.
Les exemples d’AIS AtoN réels ou synthétiques et virtuels ont les mêmes formes de base, avec une forme plus petite, délimitée par une fine ligne continue, placée au-dessus du losange. Les noms des exemples et de la forme plus petite correspondante sont les suivants :
- Marque de tribord : triangle
- Marque de bâbord : carré
- Marque cardinale nord : deux triangles empilés, tous deux dirigés vers le haut
- Marque cardinale est : deux triangles empilés, pointant verticalement l’un par rapport à l’autre
- Marque cardinale sud : deux triangles empilés, tous deux dirigés vers le bas
- Marque cardinale ouest : deux triangles empilés, pointant verticalement l’un vers l’autre
- Marque de danger isolé : deux cercles empilés
- Marque de sécurité : cercle
- Marque spéciale : X
Réflecteurs radar et balises radar (RACON)
Généralités
La détection d’une cible radar dépend avant tout de la quantité d’énergie renvoyée par la cible à l’antenne de réception du radar. Lorsqu’une aide à la navigation renvoie un mauvais écho radar, un dispositif peut y être ajouté pour produire un écho amélioré sur l’écran radar. Deux méthodes principales peuvent être utilisées pour améliorer une cible. La première comprend l’ajout d’un dispositif passif, comme un réflecteur radar, qui augmente la surface apparente de la cible, alors que la deuxième comporte un dispositif actif, à savoir une balise radar (RACON). De plus, l’utilisation de ce dernier dispositif permet d’éviter de confondre les cibles radar semblables, car il émet une trace codée qui est facile à identifier sur l’écran radar. Grâce à cette caractéristique, le RACON permet de distinguer avec plus d’efficacité des particularités ou structures importantes qui autrement n’auraient pas été repérées par les radars, comme les côtes en pente douce et les piliers de ponts.
Réflecteurs radar
Certaines aides fixes sur la côte et la plupart des bouées sont conçues et équipées de façon à augmenter la capacité des aides à réfléchir les signaux radar. Les réflecteurs radar peuvent aussi servir d’aides à la navigation indépendantes. Ces aides sont indiquées sur les cartes, et celles qui sont placées sur des aides lumineuses sont mentionnées dans la publication appropriée du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.
Balises radar (RACON)
Un RACON comprend trois éléments principaux : un récepteur, un émetteur et une antenne commune pour la réception et l’émission. Un radar, situé dans la zone de portée du RACON, interroge ce dernier pendant chaque période de rotation où son antenne radar est pointée vers le RACON. Le récepteur RACON décèle le signal radar interrogateur et déclenche l’émetteur RACON. Cet émetteur peut répondre par une seule impulsion à chaque déclenchement, mais habituellement, la réponse est une série d’impulsions codées (code Morse) identifiant le RACON. Après le déclenchement, une période limitée est allouée au RACON pour qu’il réponde. Il en résulte une émission retardée dans le temps (et en distance), par rapport à l’écho passif de la structure sur laquelle est installé le RACON. La plupart du temps, ce retard, qui équivaut généralement à une distance de moins de 100 mètres, n’a aucune importance à des distances supérieures à quelques milles marins. En revanche, à courte distance, ce retard prend de l’importance, mais l’écho de la structure de la station est habituellement visible et on peut mesurer sa distance avec toute la précision du radar.
Les opérateurs radar peuvent remarquer l’élargissement ou le rayonnement du signal du RACON lorsque leur navire s’en approche. Il est possible de minimiser cet effet en ajustant la commande d’intensité de la fréquence moyenne ou la commande d’intensité du balayage radar, ce qui réduira également l’intensité des autres cibles.
Avertissement
Il faut être prudent lorsque l’on utilise les commandes du radar. L’affichage du signal du RACON peut être pratiquement éliminé par l’utilisation de la commande de couplage à faible constante de temps du radar. De même, l’utilisation du processeur automatique d’images dont sont dotés certains radars peut supprimer le signal du RACON.
RACONS à agilité de fréquence
Ces RACON sont maintenant les plus utilisés dans les eaux canadiennes. Le RACON à agilité de fréquence mesure la fréquence et l’intensité du signal de l’impulsion radar d’interrogation, puis accorde son émetteur sur cette fréquence avant de répondre. Ce RACON assure le service à l’intention des radars des navires fonctionnant en bande X, et certaines installations assurent également un service à l’intention des radars fonctionnant entre 2920 et 3100 MHz (radars de 10 cm ou de bande S). Même s’il est possible qu’une réponse soit affichée à chaque balayage d’antenne de tout radar dans cette portée, en pratique, ce RACON est programmé pour interrompre ses émissions à intervalles réguliers pendant une période choisie au préalable, pour ne pas masquer les autres échos d’intérêt.
L’emplacement, les codes et les fréquences (X, S ou X et S) des RACON sont publiés dans les Avis aux navigateurs et figurent également dans les publications maritimes appropriées comme les Aides radio à la navigation maritime, les Instructions nautiques et le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume. Le Service hydrographique du Canada ne porte sur les cartes le code morse des RACON qu’aux endroits où l’on peut interroger plus d’un RACON à la fois.
Système mondial de navigation par satellite (GNSS)
Description du système
Le système mondial de navigation par satellite (GNSS) est un terme utilisé pour décrire l’ensemble des systèmes satellitaires fournissant des signaux depuis l’espace avec des informations de position, de navigation et de synchronisation (PNS) aux récepteurs GNSS et déterminant leur emplacement. Le premier GNSS développé est le système GPS des États-Unis. D’autres systèmes GNSS, comme le Glonass russe, le Galileo européen et le BeiDou chinois, sont également opérationnels ou en mode préopérationnel dans le but d’offrir des services de PNS similaires à l’échelle mondiale aux utilisateurs, où qu’ils se trouvent, à tout moment et par tous les temps.
Le GNSS gravite sur l’orbite terrestre moyenne (MEO) à une altitude de plus de 20 000 km de la surface de la Terre, ce qui est reconnu comme étant optimal pour les applications de positionnement, de navigation et de synchronisation à l’échelle mondiale. Les signaux du GNSS diffusent généralement un signal militaire exclusif et/ou un signal restreint, ainsi que d’autres signaux à usage civil. Les signaux de GNSS civils comprennent un signal de service ouvert qui est mis gratuitement à la disposition de tout utilisateur disposant d’un dispositif de réception compatible.
Les utilisateurs qui utilisent un récepteur monofréquence dans des conditions normales avec au moins quatre satellites en visibilité directe au-dessus d’une élévation minimale de 5 degrés sont en mesure de répondre aux exigences maritimes de l’OMI en matière de précision de la position horizontale de 10 mètres.
Norme de rendement
Les niveaux de rendement minimaux de chaque GNSS sont détaillés dans leur document de normes de rendement respectif. Ce document précise les paramètres de rendement comme la précision, l’intégrité, la disponibilité, la continuité et la santé des satellites formant la constellation et bien plus encore. Les derniers documents relatifs aux normes de rendement de chaque constellation GNSS opérationnelle sont disponibles sur Internet. Le gouvernement ou l’entité responsable d’une constellation GNSS spécifique s’engage à respecter et à dépasser les niveaux de service publiés dans leur document.
| Constellation | Norme de précision de la position horizontale (95 %) | Contraintes | Version du document |
|---|---|---|---|
| GPS (en anglais seulement) | 8 m |
|
SPS PS éd. 5, 2020 |
| Glonass (en anglais seulement) | ≤ 7,8 m | OS PS v2.2, 2020 | |
| Galileo (en anglais seulement) | ≤ 7 m | OS SDD v1.2, 2021 | |
| BeiDou (en anglais seulement) | ≤ 9 m | OS PS v3.0, 2021 |
Légende :
- SPS PS : Norme de rendement du service de positionnement standard
- OS PS : Norme de rendement des services ouverts
- OS SDD : Service ouvert - Document de définition de service
Système de renforcement du GNSS
Les systèmes de renforcement du GNSS sont des systèmes qui complètent le GNSS de base afin d’améliorer la précision, la disponibilité, la continuité et l’intégrité des applications de PNS. Ils se divisent en deux groupes distincts : les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS) et les systèmes de renforcement au sol (GBAS), où les informations de renforcement proviennent respectivement des satellites et des stations au sol.
Le système de renforcement à couverture étendue (WAAS) est un système de renforcement satellitaire (SBAS) qui complète le GNSS afin d’améliorer les informations de PNS en Amérique du Nord. Le WAAS a été mis au point par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et mis en service en 2003 afin d’être utilisé pour les tâches essentielles à la sécurité de la navigation aérienne. Une étude réalisée en 2019 par Serco, pour le compte de la GCC, a conclu que le WAAS est une solution viable pour la navigation maritime dans les eaux canadiennes.
Le WAAS se compose de trois satellites géostationnaires (GEO) et de plusieurs stations terrestres de référence, dont quatre stations de référence WAAS situées au Canada. Ces satellites GEO diffusent les informations de correction et d’intégrité GPS vers les récepteurs GPS compatibles du WAAS qui utilisent les corrections de la position et de l’horloge du satellite pour affiner leur position calculée et améliorer ainsi la précision.
Les utilisateurs peuvent s’attendre à bénéficier d’une précision jusqu’à cinq fois supérieure avec un récepteur compatible SBAS par rapport à un récepteur GPS uniquement. La limite de couverture typique du WAAS dans l’Arctique est censée être d’environ 72 degrés de latitude nord.
Norme de rendement du WAAS
La FAA s’engage à respecter les niveaux de rendement précisés dans la norme de rendement du GPS WAAS pour la fourniture du service WAAS. Le rapport de l’étude de 2019 du WAAS a démontré qu’une précision inférieure à 2 m est possible lorsque les corrections du WAAS sont appliquées.
Figure 4 : WAAS Position Accuracy. Source : (ION GNSS+2019, An Evaluation of WAAS 2020+ to Meet Maritime Navigation Requirements in Canadian Waters, G. Johnson, G. Dhungana et J. Delisle https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=16942)

Description textuelle de la Figure 4: WAAS Position Accuracy
Cette carte du Canada montre dans des tons de bleu à vert que l’erreur typique de précision de la position WAAS est inférieure à 3 mètres d’un océan à l’autre, incluant l'Arctique. Le centre, y compris les régions des Grands Lacs et de la Baie d’Hudson, montre une erreur de position inférieure à 2,2 mètres.
Dix stations, dont quatre sur la côte ouest (Prince Rupert, Kitimat, Port Hardy et Vancouver), quatre sur la côte est (St. John’s, St. John, Saguenay et Halifax) et deux dans l’Arctique (Iqaluit and Inuvik), ont recueilli des données WAAS durant la campagne de mesures.
Publications connexes
- Guide de sécurité nautique (PDF, 5,5 Ko, disponible en format PDF uniquement)
- Transports Canada publie ce guide pour s’assurer de bien faire connaître la réglementation sur la navigation, et vous permettre d’en apprendre davantage sur les pratiques de navigation sûres et responsables.
- Cette publication est disponible sur le site Web de Transports Canada sous la rubrique Transport maritime.
- Bouées privées – Guide du propriétaire (PDF, 885 Ko, disponible en format PDF uniquement)
- Le présent guide aidera les propriétaires de bouées privées à comprendre et à appliquer les lois et les exigences canadiennes et les informe sur leurs responsabilités lorsqu’ils installent une bouée privée.
- Aides radio à la navigation maritime
- Cette publication annuelle fournit des renseignements sur les centres de Services de communications et de trafic maritimes (SCTM), ainsi que sur les services de trafic maritime, les programmes d’avertissement et de prévisions des conditions et des glaces maritimes d’Environnement Canada. De plus, elle énumère l’emplacement et les caractéristiques des aides radio à la navigation maritime, c.-à-d. les RACON.
- Livre des feux, des bouées et des signaux de brume
- Cette publication inclut des renseignements sur les caractéristiques et la position des feux côtiers, des bouées lumineuses et des signaux de brume de diverses régions. Elle peut être téléchargée sur le site Web des NOTMAR en anglais et en français pour les régions suivantes. Les mises à jour y sont affichées également.
- Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
- Côte de l’Atlantique (y compris le golfe et le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal)
- Eaux intérieures (à l’ouest de Montréal et à l’est de la Colombie-Britannique)
- Côte du Pacifique (y compris les eaux côtières, les fleuves, rivières et lacs de la Colombie-Britannique)
- Cette publication inclut des renseignements sur les caractéristiques et la position des feux côtiers, des bouées lumineuses et des signaux de brume de diverses régions. Elle peut être téléchargée sur le site Web des NOTMAR en anglais et en français pour les régions suivantes. Les mises à jour y sont affichées également.
- Avertissements de navigation
- Les Avertissements de navigation (AVNAV) sont diffusés sous forme de messages radiodiffusés par les centres de Services de communication et de trafic maritimes (SCTM). Ces messages donnent divers renseignements qui ont un rapport direct avec la sécurité du navigateur (p. ex. défectuosité des aides à la navigation, nouveaux dangers, modifications apportées aux aides).
- Tables des marées et des courants du Canada
- Cette publication renferme les prévisions quotidiennes des marées pour tous les ports de référence canadiens, de même que pour les ports secondaires. Les prévisions quotidiennes pour certaines stations sont aussi incluses dans ces volumes. Les Tables des marées et courants sont publiées en 7 volumes et sont énumérées dans les catalogues des cartes marines.
- Volume 1 (PDF, 2,7 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Côte de l’Atlantique et Baie de Fundy
- Volume 2 (PDF, 3,5 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Golfe du Saint-Laurent
- Volume 3 (PDF, 2,6 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Fleuve Saint-Laurent et Fjord du Saguenay
- Volume 4 (PDF, 2,7 Mo, disponible en format PDF uniquement) – L’Arctique et la Baie d’Hudson
- Volume 5 (PDF, 10,1 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Juan de Fuca Strait et Strait of Georgia
- Volume 6 (PDF, 10 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Discovery Passage et côte Ouest de l’Île de Vancouver
- Volume 7 (PDF, 9,2 Mo, disponible en format PDF uniquement) – Queen Charlotte Sound à Dixon Entrance
- Cette publication renferme les prévisions quotidiennes des marées pour tous les ports de référence canadiens, de même que pour les ports secondaires. Les prévisions quotidiennes pour certaines stations sont aussi incluses dans ces volumes. Les Tables des marées et courants sont publiées en 7 volumes et sont énumérées dans les catalogues des cartes marines.
Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne
Administration centrale
Garde côtière canadienne
Gestionnaire nationale, Aides à la navigation
222 rue Nepean
Ottawa ON K2P 0B8
Courriel : dfo.ccgaidstonavigationconsult-gccconsultaidealanavigation.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Région de l’Atlantique
Administration centrale régionale de la GCC
B. P. 5667
St. John’s (T.-N.-L.) A1C 5X1
Centre des opérations régionales
1-709-772-6220
Courriel : dfo.ccgatlroc-coratlgcc.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Superviseur opérations, Aides à la Navigation
175 McIlveen Drive
Saint John, NB
E2L 4B3
1-506-636-4708 (Service bilingue)
Courriel : dfo.ccgatlaidstonavigation-aidesalanavigationatlgcc.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Avertissements de navigation
AVNAVs séries « N »
1-709-695-2168 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits)
1-800-563-9089 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits)
Courriel : SCTM PortAuxBasques avnav.sctmportauxbasques@innav.gc.ca
Avertissements de navigation
AVNAVs séries « M »
1-902-564-7751 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits)
1-800-686-8676 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits) (Sans frais)
Courriel : SCTM Sydney avnav.sctmsydney@innav.gc.ca
Région de l’Arctique
Yellowknife, T.N.-O.
Surintendant, Programme de navigation
Garde côtière canadienne
5120 49ième rue,
3ième étage
Yellowknife, NT X1A 1P8
867-444-0109 (Service bilingue)
Courriel : dfo.ccgarcticaidstonavigation-aidesalanavigationarctiquegcc.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Avertissements de navigation
AVNAV séries « A »
1-867-979-5269 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits)
Courriel : avnav.sctmiqaluit@innav.gc.ca
Région du centre
Québec (Qc)
Surintendant, Aides à la Navigation
1550, avenue D’Estimauville
Québec (QC) G1J 5E9
1-418-648-3574 (Service bilingue)
Courriel : dfo.rccgcentralnpansioffice-bureaudusianpncentregccr.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Avertissements de navigation
AVNAV séries « Q » et « C »
1-613-925-0666 (Service bilingue) (Les jours fériés et nuits)
Courriel : navwarn.mctsprescott@innav.gc.ca
Secteur du Saint-Laurent
Québec (Qc)
Superviseur, Aides à la navigation
1550, avenue D’Estimauville
Québec (QC) G1J 5E9
1-418-649-6999 (Service bilingue)
Courriel : aides-nav-quebec.xlau@dfo-mpo.gc.ca
Secteur des Grands Lacs
Sarnia (ON)
Superviseur, Aides à la navigation
520, rue Exmouth
Sarnia (ON) N7T 8D1
1-519-383-1871 (Services offerts en anglais seulement)
Courriel : dfo.ccgcentralatongreatlakes-grandslacsaalancentregcc.mpo@dfo-mpo.gc.ca
Région de l’ouest
Victoria (C.-B.)
Surintendant, Aides à la Navigation et voies navigables
25, rue Huron
Victoria (C.-B.) V8V 4V9
1-250-480-2602 (Services offerts en anglais seulement)
1-800-667-2179 (Sans frais)
Courriel : ccgbasevicmns@pac.dfo-mpo.gc.ca
Avertissements de navigation
AVNAV séries « P »
1-250-627-3070 (Les jours fériés et nuits)
Courriel : avnav.sctmprincerupert@innav.gc.ca
Système de balisage maritime IALA / AISM : Zones de balisage A et B
Figure 5 : Système de balisage maritime IALA / AISM

Description textuelle de la Figure 5: Système de balisage maritime IALA / AISM
Le système de balisage maritime de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM) est divisé en deux régions. La région A comprend une partie de l’océan Atlantique, l’Afrique, l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Australie et une partie de l’océan Pacifique. La région B comprend l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Ces informations sont considérées comme correctes au moment de leur publication par l’AISM (mars 2010). Elles ne doivent pas être utilisées pour la navigation et les utilisateurs doivent consulter les publications nautiques actuelles pour connaître l’état le plus récent.
- Date de modification :